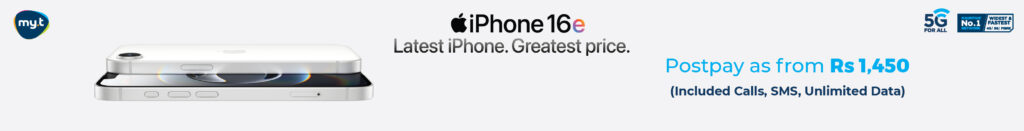Le pays célèbre aujourd’hui le 190e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Ce moment fondateur de l’histoire de l’île symbolise non seulement la fin officielle d’un système d’exploitation inhumain, mais aussi le début d’un long processus d’adaptation et de reconstruction sociale pour les anciens esclaves et leurs descendants.
Pratique aussi ancienne que l’humanité elle-même, la traite négrière transatlantique s’est distinguée par son ampleur et son organisation. Durant près de quatre siècles, entre quatre et sept millions d’Africains furent arrachés à leurs terres pour alimenter l’économie de plantation des Amériques et des Caraïbes. Dans l’océan Indien, Maurice s’est intégrée progressivement à cette économie mondiale, devenant un carrefour important du commerce des esclaves. Sous la domination française, puis britannique, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent déportés depuis l’Afrique, Madagascar, l’Inde et l’Insulinde. Les esclaves furent forcés de travailler dans des conditions extrêmement difficiles, notamment dans les plantations de sucre, qui formaient la colonne vertébrale de l’économie insulaire.
Une résistance constante avec courage et détermination
Malgré les souffrances infligées, les esclaves n’ont jamais cessé de résister. Le marronnage, qui consistait à fuir vers l’intérieur montagneux de l’île, était une forme de lutte très répandue. Certains esclaves rebelles, tels que Sans Souci, Coutoupa et Madame Françoise, sont entrés dans l’histoire pour leur courage et leur détermination à recouvrer leur liberté.
Par ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, les idées abolitionnistes ont commencé à gagner du terrain en Europe. Des intellectuels et des réformateurs comme Pierre Poivre et Bernardin de Saint-Pierre critiquèrent le régime servile, préparant ainsi le terrain pour son abolition.
L’abolition et ses conséquences. Compensation pour les maîtres des esclaves
C’est en 1833 que le Parlement britannique vota l’Acte d’émancipation, qui entra en vigueur à Maurice le 1er février 1835. Toutefois, cette liberté fut partielle : les anciens esclaves furent soumis à une période d’apprentissage, durant laquelle ils restaient sous la dépendance de leurs anciens maîtres.
Les planteurs reçurent de fortes compensations financières pour la perte de leur main-d’œuvre servile, tandis que les affranchis se retrouvèrent souvent marginalisés, sans ressources ni propriétés foncières. Cette situation mena à l’importation massive de travailleurs engagés indiens, modifiant profondément la composition ethnique et sociale de Maurice.
Un devoir de mémoire
Aujourd’hui, 190 ans après cet événement historique, l’abolition de l’esclavage reste un moment de réflexion et de commémoration. Maurice a su se forger une identité multiculturelle issue des souffrances et des résistances du passé. Des lieux de mémoire, tels que le monument du Morne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, rappellent le courage des esclaves et leur quête incessante de liberté.
Le souvenir de l’esclavage ne doit pas s’effacer. Il est essentiel de continuer à éduquer les nouvelles générations sur cette période sombre de l’histoire, afin que les idéaux de justice et d’égalité prévalent toujours. En célébrant ce 190e anniversaire, Maurice rend hommage à tous ceux qui ont souffert, résisté et contribué à bâtir la nation d’aujourd’hui. A leurs descendants aussi.
Source : Pr Jocleyn Chan Low (METRO PRESSE – Edition No. 26)